La nouvelle est tombée, comme un coup de tonnerre, Ty
Segall part en tournée. Cette tournée aurait pu rester anecdotique, si le
petit génie Californien n’avait pas imaginé un concept aussi anti commercial
que la plupart de ses œuvres . Chaque performance sera unique , le Californien jouant un disque de son répertoire lors de chaque date. Le chaland ne saura
donc pas si il aura droit au chaos bruitiste d’emotional murgger , ou aux solis
lumineux de manipulator. La démarche est d’autant plus remarquable que, à part
Dylan , aucun artiste ne s’était risqué à proposer une tournée sans dévoiler un
peu la teneur de ses concerts. L’occasion pour moi de faire le tour de son
brillant parcours à travers sa luxuriante discographie.
Premiers cris
rageurs ( 2009-2010)
Ty Segall :
Lemons
Aujourd’hui, on a l’impression
qu’un groupe doit atteindre la perfection dès les premières notes. Chaque
disque sorti sera d’abord jugé avec suspicion : Le premier Greta Van
Fleet ? Une œuvre de faussaire Zeppelinien. Blackberry Smoke ? Le
fils caché de Lynyrd Skynyrd et Blackfoot. Personne ne comprend que ces
références sont utilisées comme des paratonnerres par la plupart des jeunes
musiciens, qui risquent de devenir inaudibles, ou blacklistés, en offrant un
disque trop aventureux. Ces calculs, souvent inconscients ont influencé la
marche du rock depuis ses débuts, et un groupe ne s’éloigne en général de ses
influences qu’à partir du troisième album.
Le réel problème de notre
génération est que le punk , et le grunge qu’il a enfanté , ont niés cette
évidence. Les sex pistols avaient beau cracher sur Elvis comme sur le symbole
d’un traditionalisme honteux, leur musique n’était rien d’autre que du bon
vieux rock n roll hargneux. Les artistes ayant trouvé leur voie dès le premier
essai se comptent sur les doigts de la main , de Led Zeppelin aux Guns , en
passant par Todd Rundgren et les new york dolls (et même pour eux les
références restent visibles).
Et puis il y’a ce premier
disque de Ty Segall, lancé négligemment à la face du rock, avec la simplicité
d’un jeune musicien, qui montre déjà un certain talent lorsqu’il s’agit de
défigurer ses références. Lemons est un disque spontané, dont les rythmes sont
systématiquement salis par les riffs juvéniles d’une guitare graisseuse.
Ecoutez le hurler sur « Johnny» , sa guitare bourdonnant comme pour détruire
la cadence chaloupée de la batterie, qui n’a pas le temps de revendiquer
l’héritage de Bo Diddley. « Lovely one » pourrait d’ailleurs passer
pour un blues acoustique, si il n’était pas servi par cette voix si
particulière, et cette rythmique délirante.
Tout héritage est
systématiquement massacré dans une folie garage rock , à l’image de ce
« drop out boogie », où l’énergie viscérale du premier disque des
kinks est embourbé dans une fange aussi excitante que le disque de the go ,
première collaboration et chef d’œuvre ultime d’un certain Jack White.
Et puis il y a « like
you » , premier épisode d’une série de ballades psychédéliques s’achevant
dans un déluge sonore que n’aurait pas renié Nirvana. Le tableau est déjà
complet, et montre la folie de Ty Segall dans sa formule la plus crue, avant
qu’il ne l’adapte à ses lubies passagères.
Ici , le passé est trop
défiguré pour être reconnaissable , et si l’artiste n’est qu’un faussaire
talentueux , alors Ty Segall pourrait devenir le nouvel Al Capone du rock
moderne.
Ty Segall :
Melted
Tout commence sur quelques notes de guitares sèches ,
portant un chant langoureux de folkeux défoncé . On retrouverait presque les
décors bucoliques du San Francisco Hippie , époque de tous les fantasmes , et
l’esprit commence à se laisser aller dans ce qui ressemble à une tendre mélodie
rêveuse. Mais non , Ty Segall ne sait pas se limiter à un exercice de style un
peu cucul , il faut que sa guitare salope tout dans un joyeux brouhaha garage.
Pourtant , l’homme ne fait plus sa tambouille seul , il s’est entourer d’un
groupe , donnant à sa musique une plus grande rigueur.
Ici , c’est clairement au psychédelisme qu’il s’en prend,
à l’image de cette ouverture , où la douceur acoustique laisse place à un
délire électrique en forme de bad trip. Aussi crasseux soient ils , les riffs sont désormais calés sur un rythme
binaire , à l’image de ce « girlfriend » , un boogie spatial servi par une guitare bourdonnante. Puis vient « sad Fuzz » , une ballade
délirante dérivant rapidement dans un rock déstructuré , dans la tradition des Deviants. On retrouve en fin de
parcours ses solis , qui sont plus des notes stridentes que de petites
démonstrations de virtuosité, comme si les stooges avaient pris place pour
clôturer ce trip minimaliste.
Le grunge vient
s’inviter à la fête sur le morceau titre, Ty Segall remplaçant les gémissements
pathétiques de Cobain par une voix spatiale, les riffs plombés partant de
nouveau dans un boogie de freaks. Tout ce délire baigne dans l’acide, les voix
sont lointaines ou hypnotiques, les guitares tiennent un rythme souvent déstructuré,
comme le magic band enfermé dans un garage un soir de défonce, et le tout sonne
toujours si spontané.
Là est la force de Ty Segall , il a toujours l’air
d’improviser ses disques , comme si il se foutait éperdument de la suite. Avec
ce deuxième essai , il sonne encore comme le gamin qui vient d’apprendre ses
premiers accords , et essaie de copier ses disques psychédéliques sans être
capable d’en reproduire tous les enchainements. Et si le résultat ne vous
enthousiasme pas je ne peux plus rien
pour vous.
Goodbye breed
« Hello , Monday goodbye bread » , cette
première phrase est lâchée avec une douceur presque Byrdsienne, et quant la
guitare entre dans le bal , c’est pour suivre cette mélodie folk rock. Dire que
l’on n’attendait pas Segall dans ce registre est un euphémisme et, même quant les
riffs se font un peu plus agressifs, ils carillonnent plus qu’ils n’hurlent.
Voila donc Segall dans un style bien plus fin , les
titres sont plus carrés , la distorsion maitrisée , et une douceur mélodique
ressort de tous ces titres , même les plus rythmés. Les cœurs de « confortable
home » donnent l’impression d’entendre les beatles chanter sur un rock
binaire. Alors le solo intervient , pour rappeler que nous écoutons toujours le
garage rock de Ty Segall , mais il est plus rythmique que bruitiste.
Cette musique montre un artiste à la croisée des chemins ,
qui semble attiré par les refrains pop et les rock plus carrés , sans l’assumer
tout à fait . On pourrait appeler ce problème le « syndrome du chanteur
indé » , qui chérie son indépendance tout en cherchant à diffuser ses
inventions.
Ce problème sera récurent tout au long de la carrière de
Segall , l’homme prenant un malin plaisir à bousiller le peu de popularité
qu’il parvenait à acquérir. Ici , ce problème donne un disque schizophrène ,
dont la première partie montre un artiste d’une étonnante finesse , flirtant
avec la folk et la pop , avant que « My head explode » et ses
succeseurs ne viennent tout dynamiter à grands coups de délires bruitistes , de
violence punk ou grungy, le tout rehaussé par cette voix qui se fait plus
hurlante.
Certains diront que ces tergiversations donnent le disque
le plus faible de Segall qui , faute de choix , livre une succession de titres
originaux, mais manquant de cohérence. Il montre tous de même une inspiration
que beaucoup de ses contemporains pourraient lui envier.
Du garage rock
minimaliste au space rock sauvage (2012-2016)
Slaughterhouse
Un déluge de Feedback , voila
ce qui ouvre ce slaughterhouse , comme pour rattraper l’intro pop de Goodbye
breed, Ty Segall se roule dans sa sauvagerie avec bonheur. Il faut dire qu’il a
réuni derrière lui un groupe de fous de la distorsion, dont une partie formera
le noyau dure du groupe fuzz.
Slaughterhouse représente le
penchant le plus extrême de Segall , les riffs bourdonnent désormais sans
retenue, et ce magma sonore se déverse dans nos oreilles avec plus de puissance
que space ritual d’hawkwind. Finis les breaks hypnotiques, même sur l’intro plus légère
de « I bougth my eyes » , la guitare menaçante finit par partir
dans une secousse sonore assourdissante.
Ce disque est sans doute le
plus underground du blondinet , c’est aussi celui qui montre un de ses groupes les
plus soudés . Qu’ils lancent un riff agressif sur un rythme paranoïaque , ou
qu’ils créent une atmosphère pesante à grands coups de riffs plombés , ces
musiciens sont en symbiose parfaite, et leur musique percute vos tympans comme un monolithe
en acier.
Ce disque, c’est les fantomes
des stooges qui se perdent dans les trips d’hawkwind , et se retrouvent profanés
dans une messe païenne, ou black sabbath est sacrifié dans un déluge space
rock. La morale de cette histoire , c’est que le Ty Segall band ne respecte
rien, cette génération n’est pas la sienne et il n’est pas là pour la saluer.
Clou du spectacle , Diddie Wah Diddy , le classique de Bo Diddley est massacré
dans un déluge qui n’a plus grand-chose à voir avec l'original . Rageur, Ty Segall finit par
hurler : « Fuck that fuckin song ! I don’t know what we are
doing ! »
Nous non plus, nous ne
comprenons jamais réellement ce qu’il fait , et ce depuis ses débuts . Et c’est
bien pour ça que chacun de ses disques est une aventure, d’autant plus
fascinante qu’on sait qu’elle restera unique.
Fuzz
Il y’a eu Cream , le Jimi
Hendrix experience , maintenant nous avons fuzz. Les power trio ont souvent
servi à repousser les limites de la sauvagerie, et je ne parle même pas du
motorhead légendaire , celui de ace of spades et no sleep n till hammersmith.
Dans le cas de Ty Segall , la boite de pandore fut ouverte avec le Ty Segall
band , et son tonitruant slaughterhouse.
Plus puissant que n’importe
lequel de ses albums, ce disque représentait le Segall le plus direct , le
plus sombre , et le plus violent. Fuzz pousse le concept jusque dans le look de
ses musiciens , grimés en mimes blafards , ou en hippie gothique. Le premier
disque de Fuzz s’ouvre d’ailleurs sur un déluge de réverbs qui fait echo à
slaughterhouse, mais le power trio améliore encore cette formule apocalyptique.
Slaughterhouse était livré
avec la spontanéité d’une crise de nerf musical , et il était souvent difficile
d’identifier un riff au milieu de ce chaos. Fuzz remet un peu d’ordre dans tout
ça , la batterie redevient un gouvernail autoritaire , autour duquel le groupe
déploie une violence beaucoup plus maitrisée. De cette manière, un titre comme « What’s
in my head » peut envoyer un refrain accrocheur sans perdre la puissance
de ses riffs tranchants.
On a parfois l’impression de
passer des messes sabbatiennes à l’énergie psychedelique des pink fairies, la
discipline du groupe laissant s’exprimer un rock beaucoup plus rythmé. Moins uniforme,
fuzz surprend à chaque morceau, passant d’un riff qui donne l’impression
d’entendre Toni Iommi jouer « 21st century schizoid man » (hazemaze),
à une montée acide digne d’hawkind , sans oublier les accélérations dignes des
groupes psychédéliques les plus fous.
Pour en arriver là , Segall
martèle ses futs comme un damné , dirigeant les autres musiciens d’une main de
fer , et multipliant les roulements de toms sonnant comme une pluie de gréle
entre deux coups de tonnerre sur amplifiés.
Si Slaughterhouse était le
point de déclic qui à sans doute permis la sortie de cet album, l’œuvre finale
est une nouvelle fois très différente de celle qui l’a précédé. Ce qui prouve
encore une fois que Ty Segall ne reproduit aucun héritage , et ce même si il
s’agit du sien.
Fuzz II (2016)
Trois ans , c’est l’éternité
qu’il aurait fallut attendre pour voir un autre disque de Fuzz débarquer,
heureusement que notre peine est grassement récompensée, par un double album
réjouissant. Il faut dire que , entre temps , l’homme n’a pas chaumé ,
multipliant les albums à un rythme infernal. Ses disques se faisant parfois
plus accessibles , et on aurait pu craindre que le chanteur ne perde la recette
qu’il a lui-même inventé en 2013.
Il n’en est rien, et Fuzz II
est même le seul disque à reprendre les choses là ou son prédécesseur les avait
laissé. On retrouve donc ces guitares lourdes, cette batterie pleine
d’autorité, et une voix hypnotique, semblant sortie des plus obscures
productions de la californie psychédélique.
Les rythmes , binaires en
diable , posent la charpente sur laquelle s’élèvent les solis graisseux de
Charlie Moothart. Là dessus, divers effets sonores viennent colorer le monument,
donnant à ces rock sabbatiens les ambiances paranoïaques d’un mauvais trip.
Comme sur tous ses disques,
Segall aime glisser quelques surprises , comme la mélodie incroyablement
accrocheuse de Let It live . Les
guitares semblent toujours sorties de la forêt dépeinte sur le premier
album du sabb, mais c’est une noirceur plus entêtante qui se dégage de ce titre.
Au bout du compte , c’est bien
cette simplicité qui empêche ce disque de tomber dans la fange prétentieuse dans
laquelle patauge metallica , maiden , et tous ces sagouins suffisants. Fuzz
les renvoie tous à leurs cirques grandiloquents, et leur réapprend les vertus
de riffs simples, envoyés à fond les ballons.
Vers une première consécration
(2011-2014)
Twins
Avril 2011, Ty Segall s’ennuie, il n’a pas produit
d’albums depuis plusieurs mois, une éternité pour un hyperactif de sa trempe.
Il réunit donc son groupe et, pour combler ce temps libre , il joue des reprise
de T Rex pendant que la console
enregistre l’événement. Relativement onéreux pour un disque aussi court , l’EP
ne s’est pas beaucoup vendu , mais cela n’a aucune importance.
En rendant hommage au groupe de Marc Bolan , Segall se
faisait les dents , flattant sa future victime pour mieux la plier à ses
volontés excentriques. Le glam , voila la nouvelle matière qui excite son
extraordinaire imagination , mais il n’est toujours pas question de chanter la
nostalgie de cette époque dominée par mott the hoople et autres Bowie.
Dans l’univers de Segall, les riffs délicats de Ziggy
Stardust côtoient le heavy rock de black sabbath , et le grunge tonitruant des
années 90. Hors de question pour lui de se servir d’un genre aussi séduisant
pour flatter le grand public, twins ne contient d’ailleurs aucun tube. Si
« sinner » démarre sur une petite mélodie entêtante, ce n’est que
pour nous préparer au grondement apocalyptique de « ghost », dont le
riff gras n’aurait pas fait tache sur le premier album du sabb.
On retiendra tout de même ces accalmies, où la guitare
sonne comme un carillon bienveillant , cette voix entêtante au milieu de la
tempête , et la mélodie presque douce de
love fuzz , le titre le plus proche du glam originel.
On retiendra aussi ces solos , toujours courts mais plus
soignés . Les disques précédents avaient révélé le songwritter , ici on entrevoit
timidement le guitariste, et il n’est pas moins doué. Alors , bien sur , le
tout est encore noyé dans un revigorant bain de feedback , comme une splendeur
solaire laissant place au déluge, mais une nouvelle ère s’ouvre clairement pour
Segall.
Sleeper
On a souvent comparé Ty Segall à Kurt Cobain , dans
l’espoir de lui faire enfiler de force un costume de sauveur du rock dont il ne
veut pas. Les deux hommes ont tout de même des similitudes, leur culture
musicale, nourrie par les seventies, leurs méfiances vis-à-vis du show business
, mais concernant leurs œuvres la comparaison ne tient que pour ce sleeper.
Le disque qui fit passer Cobain à la postérité n’est pas
Nevermind , mais le Unplugged diffusé sur MTV, et sorti en disque après sa
disparition. Nevermind montrait un voleur habile, bricolant le grunge pour en
faire une nouvelle power pop, unplugged dévoilait plutôt l’artiste dans toute
sa splendeur. Sans ce disque, Nirvana serait resté le joujou de vieux nostalgiques
, mais le passage acoustique a apporté un éclairage nouveau sur son œuvre , qui
est plus fine qu’elle en a l’air.
Pour Segall , la démonstration n’était plus à faire ,
tant son œuvre a conquis une multitude de territoires sonores, pour y imposer
sa patte. Mais « sleeper » est un disque plus intimiste, où le
chanteur parle pour la première fois de lui, réglant ses comptes avec sa mère,
et pleurant la disparition de son père.
C’est sans doute ce deuil qui rapproche le plus
« sleeper » du chef d’œuvre acoustique de nirvana, les deux disques
étant marqués par la même douceur triste. Cette proximité est palpable sur
« she don’t care » , dont le violon plaintif rappelle Cobain chantant
les bluettes nostalgiques des Meat Puppets. Placé en ouverture,
« sleeper » est tout simplement sa plus belle mélodie , un monument
de beauté acoustique qui va droit au cœur.
Puis il y a « 6th street » et « sweet
CC », qui renoue un peu avec ses rythmes excentriques, sans perdre cette
douceur acoustique et méditative. « queen lulabye » revient à un
rythme plus pesant , la mélodie est encore belle mais on la sent chargée de
douleur. Sa voix elle-même étonne, et
ressemble à un mélange de John Lennon période imagine et du grand Dylan, dont
certaine piste rappelle la beauté poétique.
Quasiment
entièrement joué en acoustique, Sleeper impose définitivement Segall comme le
songwritter le plus brillant de notre époque. La variété de ses influences est
toujours très présente , et va du blues acoustique au spleen bucolique de
l’unplugged de Nirvana.
On osera pas dire qu’il s’agit de son meilleur disque, ses œuvres étant trop différentes pour être réellement comparables , il s’agit
toutefois d’un album d’une importance capitale.
Manipulator
Si l’histoire ne devait en retenir
qu’un ce serait sans doute celui là. Tranchant avec ses habitudes , le projet
« manipulator » a muri pendant plus d’un an dans l’esprit de notre
angelot. Une éternité pour celui qui a toujours balancé ses idées dans
l’urgence. Il faut dire aussi que , cette fois, Ty Segall a tout pris en charge
, de la batterie à la guitare , pour mieux maitriser un disque en forme de
grand inventaire.
Pour Twins déjà , il avait
attendu six mois avant de terminer le disque , histoire de s’immerger au
maximum dans ses inspirations glams. Sleeper , lui , montrait un artiste
d’autant plus investi qu’il se mettait en avant pour la première fois et ,
même si il fut expédié le plus vite possible , ses sonorités folks ne pouvaient
que marquer l’œuvre de Segall.
Résultat , Manipulator est un
disque synthétique , la fureur stoogienne rencontrant les mélodies raffinées de
Marc Bolan , alors que guitare sèche et électrique fusionnent dans des morceaux
de bravoures rappelant le Bowie de « the man who sold the word ».
Et surtout , le guitariste ne
c’est jamais autant lâché, ponctuant ses glams heavys de solos lumineux . Sur
« It’s over » la guitare débarque comme un ouragan au milieu d’une
pleine luxuriante, et déploie sa beauté ravageuse pendant de nombreuses
minutes. Il réitère l’expérience sur « the crawler » et , ce talent de soliste , qui se révélait timidement lors des courtes démonstrations de twins , explose
ici dans une formule inédite, où les refrains entêtant partagent l’affiche avec
des grondements rageurs dignes de fuzz.
Mais il ne faudrait pas croire
que ce disque se résume à cette violence à peine contenue par une timide
guitare folk, et des refrains à faire pâlir Ziggy Stardust. L’ange blond est
aussi un grand trousseur de mélodies psychédeliques et , quant il renoue avec
la folk de Sleeper (« don’t want to know – the clock) , on croirait
entendre Arthur Lee dans ses plus belles œuvres.
En laissant macérer son œuvre
pendant des mois , Segall à pris le temps de trouver un équilibre idéal entre
la folie garage de ses débuts, et le travail que nécessitait ce glorieux résumé
de plusieurs années d’expérimentations folles. Le résultat est un classique tout
simplement.
Fuck off ! (2016-2017)
Emotionall mugger
Manipulator fut bien le carton critique qu’il devait
devenir, et , même si il n’eu pas le succès commercial d’un nevermind , tous
s’accordèrent à dire que « Segall a trouvé sa voie ». Comme si ses
disques précédents n’avaient servi qu’à préparer le terrain au garage glam
superbe de manipulator. L’analyse était simpliste, et a sans doute irrité notre
blondinet. On a donc vu sortir un seul EP, sur lequel une presse en manque de
nouveautés s’est jetée , puis « emotionnal mugger » est enfin paru en
2016.
Imaginez la douche froide qu’ont du prendre les critiques,
convaincues d’avoir enfin compris le mystère Segall , qui leur disait
maintenant d’aller se faire voir, avec son plus grand délire bruitiste. Si
« emotionnal mugger » est grand, c’est parce qu’on a pas vu une telle
réaction d’humeur depuis le soudain revirement country de Bob Dylan. Ce qui
rassurait les critiques, et nous faisait craindre l’entrée de Segall dans le
rang des artistes formatés, est balayé d’un revers de main, confirmant ainsi
qu’écouter un nouveau disque du blondinet sera toujours une expérience inédite.
Car « emotional mugger » n’est pas non plus un
retour au chaos assourdissant de Slaughterhouse. Le changement n’étant pas tant
dans la façon dont l’album fut enregistré, mais dans son mixage. Pour
l’enregistrement, Segall est revenu à ses vieilles habitudes, balançant ses
compositions d’une traite , avant de tout rebricoller en studio. Et là ,
l’homme s’est transformé en Zappa du rock garage , mixant certains titres 4 ou
5 fois , et s’amusant avec les effets sonores.
Résultat, presque chaque composition est mixée de façon différente, et le
son va parfois d’une basse à l’autre, comme pour voyager dans nos cerveaux . C’est
pour ça qu’il faut écouter ce disque au casque, pour en ressentir l’effet.
Délicieusement expérimental, « emotionnal
mugger » ne se livre pleinement qu’après plusieurs écoutes intensives, et
devrait permettre de faire le tri entre les moutons ayant suivi la mode
manipulator , et les amateurs de folies sonores.
Ty Segall
Il fallait laisser un peu de temps , pour que les
expérimentations de emotionall mugger puissent imprégner nos cerveaux innocents . C’est pourquoi Ty Segall a attendu un an avant de lui donner un successeur. Et
quel successeur, après les bidouillages de l’album precédents , « Ty
Segall » est un de ses disques les plus punks , et les plus stoogiens.
L’ombre des frère Asheton plane sans cesse sur ces riffs
redevenus minimalistes et gras, avec cette voix beaucoup plus direct , pour
ajouter à la rugosité du tout. C’est criant sur le morceau d’ouverture, un
hymne nihiliste du niveau de « 1969 ». Puis l’acoustique revient
donner un peu de grandeur aux riffs protos punk , qui restent toutefois trop
graisseux pour rapprocher des garages rocks de la trempe de
« freedom » ou « warm hand » des solos lumineux de
manipulator.
Dans les passages les plus violents , on assiste à une
relecture du grunge le plus cru , où les guitares bourdonnent sauvagement ,
avant de partir de nouveau sur un boogie délirant au milieu de warm hands. Ce
dernier à tout d’un nouvel hymne Segallien , les passages les plus rugeux
n’empêchant pas la mise en place d’apartés particulièrement entrainants. Le
rythme redevient plus carré , avant que la guitare ne lui coupe le sifflet dans
un torrent crasseux, capable de faire passer le premier nirvana pour un sympathique
disque pop.
Puis vient « talkin », ballade enjouée, qui
semble se moquer d’une génération dont Segall fuit les mœurs hypocrites, son
refrain minimaliste entre rapidement dans la tête de l’auditeur. L’homme a toujours cette capacité à inventer
des mélodies irrésistibles , et « take care » creuse le même sillon
moqueur que « talkin ». Ce qui unit ces ballades aux déluges
qui les entourent, c’est cette simplicité presque enfantine .
« talkin » se calle sur un rythme presque léger , les riffs sont plus
de courtes secousses sonores que des démonstrations alambiquées, et le tout sonne
comme un groupe enregistré dans son garage pendant une répétition.
Après avoir limité son public à ceux qui aimaient son excentricité,
à défaut de la comprendre pleinement, Segall s’amuse en toute simplicité. La première prise est souvent la bonne, voici
la sympathique philosophie qui a guidée le blondinet lors de l’enregistrement de
ce disque.
Nouvelle
bombe pop ?
Freedom Goblin
Ty Segall fut, pendant des années, un ouvrier
productif, mais pas assez appliqué. Ses albums étant souvent trop brouillons
pour l'extirper de son Underground chéri. Les premiers frémissements n’auront
lieu qu’en 2014, avec la parution de Manipulator. Le disque trouvait pour la
première fois un juste milieu entre la violence de son Garage Rock et la
douceur exigée par la Pop.
L’artiste veillant à conserver une certaine
discrétion, en détruisant toutes ses fan-pages sur les réseaux sociaux, l’album
a fait l’effet d’une bombe. Entre énergie Stoogienne et charme Glam,
Manipulator aura fait naitre le phénomène Segall, avant que l’intéressé ne le
dynamite purement et simplement.
Loin de surfer sur ce premier succès, ce musicien
prolifique a passé les mois suivants à produire des disques résolument violents
et crasseux, sans être dénués d’intérêt. Résultat, le soufflet est retombé, ses
disques ont quitté les têtes de gondole des grandes surfaces du disque et
autres librairies grand public. Et un auditoire aussi séduit que curieux
continua à suivre cet énigme Rock.
Ty Segall s’affirmait comme le digne descendant de
Neil Young, Bowie, et autres expérimentateurs Pop, brouillant les pistes à
chaque nouvel album. Rien que pour avoir redonné au Rock sa part de mystère, qui
érigeait les Rock-star au rang de héros excentriques, et faisait des
Rock-critiques des messagers, lus avec avidité par toute une jeunesse, Ty
Segall méritait toute notre reconnaissance.
Mais voila qu’en 2018, après avoir passé des années
à suivre le fil de sa féconde inspiration, le Californien nous offre LE disque
justifiant tous les autres. Cette phrase ne veut pas dire que les opus
précédents ne sont plus aussi probants. Ils font, au contraire, partie des
œuvres les plus passionnantes de ces dernières années. Mais avec Freedom
Goblin, Segall semble boucler un nouveau cycle.
Pour perpétuer le coté énigmatique de son œuvre,
l'album est doté d’une pochette psychédélique, où le nom de l’artiste et de
l’œuvre n’apparaissent pas, si ce n'est sur la tranche. De psychédélisme, il en
est question dès le premier titre, "Fanny Dog", ouvrant le bal sur
une véritable fanfare de camés, que n’aurait pas renié Gong.
Dans Les Portes de la Perceptions, Huxley
décrivait le LSD comme un moyen de voir le monde dans sa globalité. Comme si le
consommateur atteignait un niveau supplémentaire de Conscience. C’est un peu ce
qui semble être arrivé à Ty Segall sur cet album. Après avoir fait l’inventaire
des différentes sonorités l’ayant fascinés, en les adaptant comme un élève appliqué,
il se met à jouer avec, les mixant dans un disque aussi riche que cohérent,
avec comme fil rouge, ces riffs crasseux dignes de Blue Cheers.
"Rain" n’aurait pas fait tâche à coté des
refrains Glams de Manipulator. "The Last Waltz" est un véritable Folk
de poivrot. Cette même Folk se fait plus mélodique sur "I’m Free". Et
n’oublions pas le gros Hard Rock qui tache "She", où la violence
grandiloquente d’un Free Jazz doté d’une section de cuivres irrésistibles
("Talkin 3").
Et il faudrait encore des pages pour analyser
totalement cette série de curiosités, de mélodies loufoques et autres
bidouillages, qui sont autant d’outils permettant à Ty Segall de dépoussiérer
ce qui fit la grandeur du Classic Rock. Et pourtant, les moyens utilisés ici ne
sont pas énormes, et le blondinet ne s’est pas embarqué dans des bricolages de
studio alambiqués, des expérimentations électroniques et autres bidouillages
sophistiqués. Qu’elle soit accompagnée de cuivres, ou qu’elle mette en valeurs
des chœurs plus « identifiables » que sur les disques précédents,
c’est bien la guitare qui est au centre de ses compositions.
Création d’une image mystérieuse, réinvention d’un
patrimoine que certains croyaient stoïques, et retour au culte du Guitar Hero,
voila les mots d’ordre de notre homme. Je ne sais pas si ces éléments font de
lui le dernier des rocker mais, une chose est sûre, Freedom Goblin
redonne une définition de ce qu’est le Rock en 2018. Et c’est déjà énorme.
Le complexe de
l’underground
Joy

Je pense aussi que ce jeune Californien a le
complexe de l’Underground et soigne régulièrement sa liberté chérie en créant
un torchon magnifique, pour succéder à chacune de ses œuvres trop propres.
L’artiste sent venir le succès comme un apache sent arriver le flingue de
Custer. Alors il bousille tout, oublie les mélodies qu’il vient à peine
d’inventer et va exactement là où il sait que le plus grand nombre ne le suivra
pas. Freedom's Goblin était trop accessible ? Ce n’était qu’une pause
après un chaos sonore digne des plus belles heures des Stooges. « Baby,
casse ta guitare. Moi je serais au bar », dit il, comme si la musique de
l’album Ty Segall n’était pas déjà un puissant bras d’honneur à ce qu’il reste
du musique business. Parce que, à une époque où le Rock est devenu horriblement
respectueux, Segall passe son temps à danser sur le cadavre du Wok 'n Roll.
Aucune étiquette ne semble réellement lui aller, et il passe son temps à les
remettre en question. Son début de carrière, il l'a utilisé pour revisiter les
genres, se faisant les dents en déchiquetant le Grunge , le Space Rock , le
Stoner… Et puis il a commencé à tout mélanger et sa musique faisait alors penser
à la phrase de Beefheart « Je manie les sons comme une palette de
couleur », Segall était arrivé à cette même pureté innocente. Comme
si ça ne suffisait pas, le voila qui demande à White Fence de le rejoindre,
cette collaboration étant sensée augmenter sa créativité.
Les deux hommes partagent la même obsession pour
l’originalité, l’inédit, le jamais vu, bref pour tout ce qui devrait être le
Graal de tous rocker qui se respecte.
Autant dire que, maintenant plus que jamais, le
respect du passé ne les atteint pas. Joy se moque des techniques de jeu et de
composition. C’est la réunion de deux fous-furieux qui partent dans tous les
sens. Les mecs ont enregistré le bazar en quelques semaines, sans doute sans
savoir où ils allaient, comme deux gamins qu’on auraient laissé s’amuser dans
un magasin de musique. Coté production, la musique et le son sont si basiques
qu’on croiraient entrer dans une caverne, pour écouter les Pierrafeu faire
rugir les amplis. Segall et Fence essaient, et en profitent pour ridiculiser
Kurt Cobain sur un Grunge caricatural. Il est bon de tuer régulièrement ces
vieilles badernes. D’ailleurs les voila qui dansent sur le macchabée le plus
regretté du monde, fredonnant "Rock Is Dead" comme pour annoncer
« il serait peut être temps de passer à autre chose non ? ». Et
les musiciens moulinent, manquant de ce casser la figure à chaque accord
faussement bancal, avant de rétablir l’équilibre dans une fiesta de riffs
acidulés. Sur Joy, Ty Segall et White Fence semblent au bord du gouffre en permanence,
mais la chute tant redoutée est toujours miraculeusement évitée.
On n'a plus entendu d’exercice de funambules Rock
pareils depuis le "Trout Mask Replica" de Beefheart, et c’était il y
a déjà cinquante ans ! Ce disque n’est pas un simple album de Rock, c’est
un lavement salvateur pour tous ceux qui, comme la majorité du monde
occidental, mangent du conformisme à longueur de journée. Joy les prendra aux
tripes, nettoiera tout ça, et ils pourront entrer dans le rang des rares
individus sains d’esprit de cette époque de tarés !
Live
Deforming lobes
Le guitariste
s’avance vers le public , avec un air faussement solennel , et déclare «
ladys and gentlemen the … » Il n’aura même pas le temps de finir , coupé par
une explosion de guitares saturées ,qui semblent prendre tous le monde par
surprise. Toute la philosophie de Ty Segall est déjà là, il veut en dire le
moins possible, sa musique étant sensée parler d’elle-même. Ce n’est pas pour
rien qu’à l’heure des réseaux sociaux, il s’obstine à se tenir éloigné de tous
ces attroupements virtuels , où toute pensée sincère est noyée par
l’hystérie d’une masse bêlante.
Ce n’est pas pour
rien non plus que l’homme démarre les festivités avec « warm hand » , titre
issu de son disque "Ty Segall" , qui revient à une musique plus
crue après la superbe pièce montée qu’est freedom goblin. Car musicalement
aussi, Ty Segall est insaisissable. Changeant d’influences comme il change de
chemise, il semble découvrir ses coups de cœurs en même temps qu’il se les
approprie. Et c’est précisément ça qui fait de lui le rocker le plus
passionnant de ce siècle terne, il enchaine les découvertes et expérimentations
comme si chacune devait être la dernière.
Alors , on aurait
pu s’attendre ici à un inventaire minutieux de toutes ses expérimentations , le
glam de Twins faisant place au space rock de slaughterhouse , avec les mélodies
folk de sleeper comme tendres intermèdes. C’est mal connaitre le Californien
qui, même sur scène , se refuse à jouer deux fois la même chose.
Ayant attiré Steve
Albini , qui produit ce live , Segall ne va pas se contenter de répéter
consciencieusement ce que son public a entendu sur disque. Albini a produit
ce qui restera le meilleur disque de Nirvana, et le freedom band veut lui faire
revivre l’excitation de cette époque, où le rock fut secoué par son dernier
grand courant musical.
Et pour cela un seul
mot d’ordre : Toujours plus fort, toujours plus lourd, toujours plus sale. Les
guitares bourdonnent, couinent, se posent parfois pour écraser les spectateurs
sous la lourdeur de breaks pleins de distorsions, pendant que Segall hurle au
milieu du déluge. Et tous ce magma sonore, ce génial grondement électrique , le
freedom band l’improvise sans filet , renouant ainsi avec la puissance d’un
Kurt Cobain chantant « Smell like teen spirit » pour la première fois.
Quant le groupe
calme le jeu , lors d’intermèdes sabbatients plombés , ou de passages boogies ,
il plane toujours une tension irrésistible , on sait que ces pauses vont
forcément aboutir sur une autre explosion sonore.
Le freedom band n’est pas
kadavar , ses instrumentaux sont réduits à la plus simple expression , et ne
durent que quelques secondes. Ces quelques secondes , loin des passages virtuoses
des hard rocker , sont souvent là pour accentuer l’agressivité de ces riffs
crasseux , quant ils ne partent pas dans un enthousiasmant bazar électrique.
Avec ce live , le
freedom band montre sa musique la plus radicale , la scène lui permettant de se
défaire de tout calcul artistique . Albini a parfaitement respecté cette volonté
de tout miser sur l’urgence et l’efficacité, et s’est contenté de rendre chaque
instrument audible, donnant ainsi l’impression d’être dans la salle. Le
résultat est un autre album majeur de Ty Segall , et la preuve que le rock peut
encore prendre l’auditeur à la gorge , et ne plus le lâcher pendant une demi
heure.
![[WebZine] ROCK In Progress](http://3.bp.blogspot.com/-eShAvmI56Sg/XCZThlRwdDI/AAAAAAAAAos/19T4foqHca46LjcWYH5V5ZbMmPx6o8UkACK4BGAYYCw/s1000/banni-RIP01%252Bfiltres.jpg)







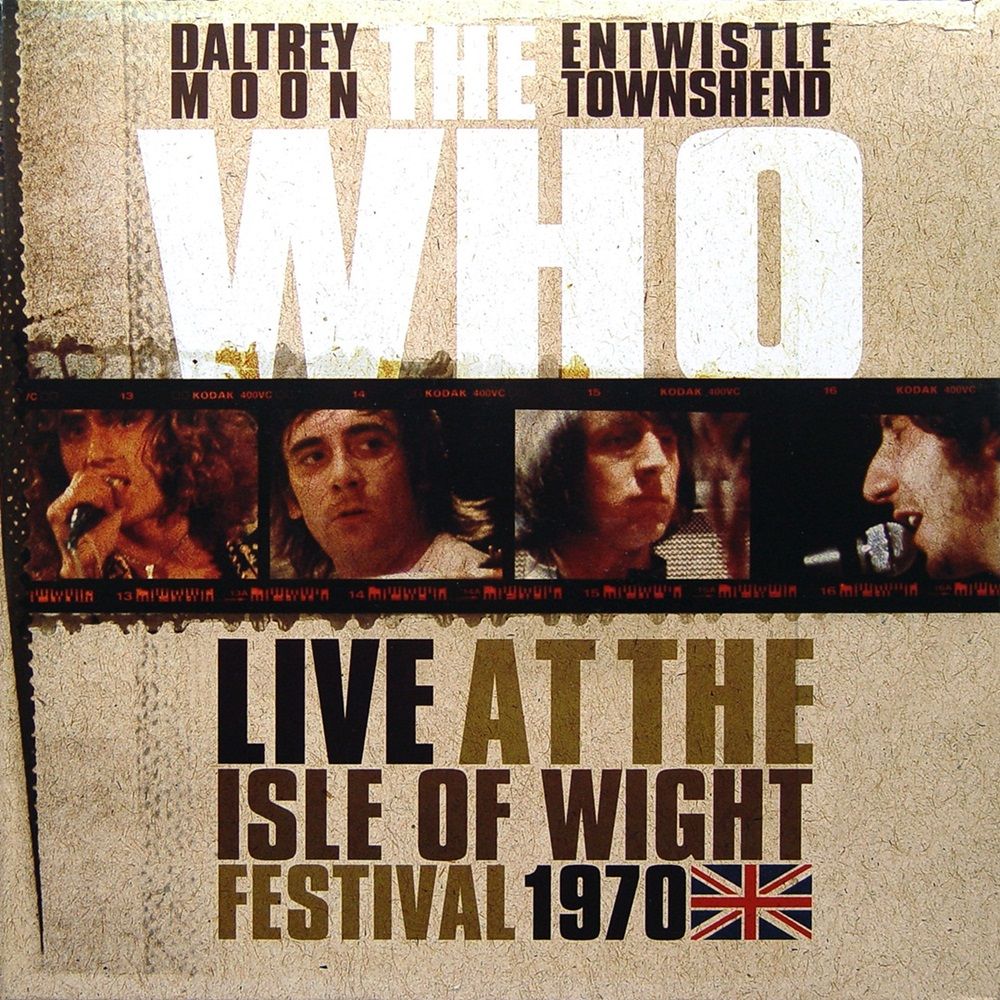


:format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-1870129-1249060232.jpeg.jpg)







:format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-6019037-1408967470-1019.jpeg.jpg)
/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/48609233/unnamed.0.0.png)



