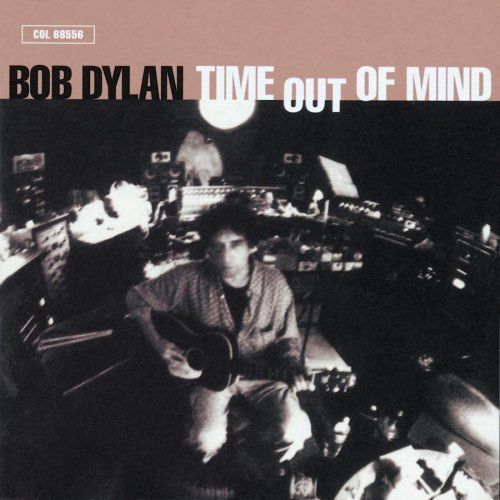La nouvelle parue quelques mois plus tard, Dylan venait
d’avoir un accident de moto. La pression mise sur ses frêles épaules avait fini
par le toucher gravement, et l’incitait à se cacher pendant plusieurs mois.
Adoré par une partie du public, détesté par celle qui avait vu ses débuts, le
barde était au milieu d’une pièce dont il ne voulait plus jouer le rôle
principal.
Son accident lui donnait une chance d’échapper à l’hystérie
qui l’entourait, et de devenir un père de famille comme les autres. On le
savait pourtant déjà actif, jammant dans la cave poussiéreuse de sa maison de
woodstoock , comme un ermite se préparant à renaitre. Les cassettes de ces
jams s’échangeaient déjà sous le manteau, sans que l’on sache qui a bien pu capter
les dernières pépites d’une mine devenue inféconde.
Ces titres électriques ne laissaient pas présager le choc
qui attendait les nouveaux Dylanophiles. Le guide générationnel s’était mué en
père de famille comblé, et il développait désormais une musique retranscrivant
cette sérénité retrouvée.
Sorti en 1969, après près d’un an de silence, John
Whesley hardin montrait que Dylan n’était jamais où on l’attendait.
« John
Whesley Hardin
Was friend to the
poor
He traveled with a
gun in every hand
All along the
country side
He oppened many
doors
But he was never
know
To hurt an honnest
man »
Le poète beat faisait place à
un countrymen contant la vie des légendes de l’ouest, et le progressisme
faisait place à la tradition, incitant le poète à nourrir sa prose de récits
bibliques.
« Well Juda
, he just winked said
All right . I’ll
leave you here
But you better
hurry up and choose which of thoose bills you want
Before they all
disepear
I’m gonna start my
piking right now
Just tell me where
you ll be
Judas point down
the road
And said eternity »
Celui qui avait conduit ses
auditeurs sur le chemin du changement brusque et sans retour, racontait des
récits à la gloire chère à l’Amérique profonde. A ce titre, la nouvelle version
de girl from the north country était tout un symbole. Sortie sur un « nashville
skyline » encore plus Countryman et léger que son prédécesseur, elle
entrait désormais dans les terres ancestrales de la country , grâce à la voix
de baryton de Johnny Cash.
Dylan espérait sans doute qu’on
le lâche , que son statut de guide s’évanouisse dans sa célébration country,
musicalement il obtint le contraire. L’arrière garde psychédélique , qui avait grandi
avec ses chanson , ne pouvait que suivre ses pas pour sauver sa peau. Cela
donnera « hot tuna » , disque country blues enregistré par d’ex
Jefferson airplane , le workinman’s dead du grateful dead , et sweatheart of
the rodeo des Byrds.
Ajoutez à ça la reprise
tonitruante de « all along the watchtower » d’Hendrix, et vous
obtenez un écho qui maintient désespérément son créateur au sommet de la mêlée.
Il faudra un troisième disque pour que l’artiste parvienne à effectuer son hara
kiri artistique.
Sorti à peine un an après Nashville
Skyline , self portrait est , dans ses meilleurs moments parcouru par un charme
bluegrass rappelant vaguement le band. Mais ses rares éclats étaient noyés dans
une bouillie infâme et indigeste, où Dylan chantait comme un crooner
léthargique.
Alors, on crucifia l’idole, en
rabâchant sans cesse l’évidence, son dernier disque était une daube putride. Le
mythe fut si bien détruit, que certains pensent encore que sa carrière est réellement
morte avec ce self portrait.
Le disque ouvrit surtout la
voie à new morning, album qui parvient à mettre un peu d’ordre dans le bazar grandiloquent de son prédécesseur. Le rock n’avait pas encore terminé son
retour à la terre, mais celui-ci s’exprimait désormais à travers le blues
abrasif de rednecks bourrus.
New morning trempait ses
racines dans la même source que les contemporains de Lynyrd, mais il l’exprimait
avec une classe mélodique plus apaisée. Dernier chapitre de sa période bucolique,
son passage dans Pat Garett et Billy the kid ne fut pas des plus mémorable. Le
film manquait de consistance, et Dylan semblait perdu au milieu de son
intrigue. La bande son lui permit au moins d’écrire « knocking on
heaven’s door », qui deviendra un tube planétaire.
Mais comme à son habitude,
Dylan est déjà passé à autre chose quand son public découvre son dernier
album. De retour avec le band, il
reprend les choses là où « blonde on blonde » les avait laissés.
Sorti en 1974, Planet waves sera un de ses plus grand succès, c’était pourtant
le disque le plus prévisible qu’il ait jamais écrit.
A l’image de la version
country de « forever young » , le disque semble remplir un vide dans
la carrière du chanteur. C’est une dernière concession faite aux nostalgiques
de l’époque où il se battait pour imposer son virage électrique , un joujou
pour fans nostalgiques.
Coincés entre le rock poussiéreux
du band , et un reste d’influence country , Dylan mélangeait maladroitement les
deux. Le band a d’ailleurs avoué qu’il avait accepté la tournée qui suivit pour
renflouer ses caisses.
Dylan n’était plus à l’aise
dans ces gigantesques célébrations, où le public semblait plus désireux de s’amuser
que de réellement écouter sa prose. Et, du côté de sa vie personnelle , le
bilan n’était pas plus brillant, et celle qui lui avait apporté un certain
équilibre semblait prête à mettre les voiles.
La longue fresque « sad
eyes lady of the lowland », les rythmes bucoliques de sa période country,
une bonne partie de l’âge d’or de Dylan fut influencée par la présence
rassurante de Sara. Son départ progressif va influencer un nouveau virage, plus
intimiste et méditatif.
Avec Blood on the tracks ,
Dylan devenait le Dostoïevski du rock , mais les âmes désespérées que ses vers
dessinaient n’étaient qu’une métaphore de ses tourments. Le disque fut
unanimement salué comme « le grand retour du génie Dylanien », alors
que son auteur avait déjà abandonné la nostalgie de ce disque.
Nous sommes en 1976, et une
musicienne se balade dans les rues de new york avec son instrument à la main.
Une voiture s’arrête près d’elle, et la conductrice lui demande si elle
souhaite participer à un enregistrement au studio columbia. Cachée par son ombre,
elle ne reconnait pas le passager qui semble être à l’origine de cette demande.
Dylan avait embauché Scarlett Rivera simplement parce qu’elle portait cet étui
à violon, violon qui illuminera la musique de desire.
L’idée menant à l’enregistrement
de desire est née à Saint Marie de la mer, où Dylan était parti s’exiler
quelques jours. Le soleil était à son Zenith , et ses rayons éclairaient une
plage proche des décors de cartes postales. Un rassemblement attira son attention.
Les gens du voyage étaient venus célébrer leur liberté sur cette plage, et
leur joie attirait le poète.
Le voilà donc au milieu au
milieu de chants mystiques, blues tzigane irrésistiblement festif. Alors forcément,
quand il dit qu’il est musicien à une audience qui ne le connait même pas de nom,
on lui tend généreusement une guitare. Il invente donc une mélodie enivrante,
et les mots lui viennent si naturellement , qu’il semble possédé par un esprit
supérieur.
« One more
cup of cofee for the road
One more cup of
cofee where I go
To the valley
bellow »
Ce jour-là, au milieu de ces
gens qui ne connaissaient pas son nom, Dylan a retrouvé la joie de jouer pour
le plaisir. Si chaque auditeur tente désespérément de retrouver les sensations procurées par son premier coup de cœur musical, le musicien lutte pour garder
la fraîcheur de ses débuts.
L’artiste n’est jamais aussi
bon que quand il est pris d’une frénésie créatrice. Les œuvres qu’il produit
peuvent alors être un peu bâclées, son esprit partant taquiner d’autres muses
avant de terminer son ouvrage. Mais l’esquisse qui naît ainsi est dotée d’un
charme qui aurait été tué par un processus plus méticuleux. Notre culture n’est,
en fin de compte, qu’un amas de brouillons fascinants.
C’est précisément cette
frénésie qui fit naître « desire », alors que blood on the traks n’était
dans les bacs que depuis quelques mois. Le fossé qui sépare les deux œuvres est
impressionnant. Torturé et grave, blood on the tracks est un disque introspectif,
dont la sobriété renforce la puissance émotionnelle.
Desire , au contraire , est un
disque électrique , festif , et foisonnant. C’est la célébration d’un homme qui
a trouvé une nouvelle voie, et la folie de ses débuts. Quand il a fallut
promouvoir le disque , Dylan refusa clairement de retrouver la grandiloquence
vulgaire des tournées des stades.
Il recontacta Joan Baez , qu’il
n’avait plus vue depuis son retour d’Angleterre , ainsi que Roger Mcguinn , et
une poignée d’amis recrutés sur la route. Voilà donc nos clochards célestes embarqués
dans un van, tels de jeunes idéalistes à la recherche de la gloire.
La rollin thunder revue était
une catastrophe financière, en grande partie financée par Dylan lui-même. Mais
c’est justement ce que son initiateur cherchait, il voulait retrouver l’énergie
de celui qui lutte pour imposer son art.
Les premiers concerts furent grandioses,
une expression de liberté comme le rock en connaîtra de moins en moins. Placé
en ouverture, « When I paint my masterpiece » était une bluette nostalgique
introduisant parfaitement la cérémonie.
Nostalgique , cette tournée l’était
en partie. Le point d’orgue du concert était d’ailleurs le duo Dylan Baez , le
roi et la reine de la folk ressuscitant le temps d’une tournée. Baez n’a d’ailleurs
jamais si bien chanté que sur ce « dark as donjons » poignant, il
faut dire que le groupe développait une folk spirituelle des plus raffinées.
Quelques minutes plus tard, la
performance se concluait sur « this land is your land » , où Dylan
rend hommage à Guthrie , en compagnie de Jonie Mitchell et Roger Mcguinn. Cette
chorale finale représentait bien l’esprit bon enfant d’une tournée aussi
spontanée que mythique.
Certains purent surtout se délecter
des meilleurs versions de classiques du répertoire Dylanien, comme « sad
eyes lady of the lowland », « tumbled up in blues » , et autres brûlots
lyriques réadaptés par un groupe bluegrass folk.
Mais les lois du marché sont impénétrables,
et le déficit força Dylan à côtoyer de nouveau les stades qu’il maudissait. De
ce retour forcé naîtra « hard rain » , un live terne et déprimant comme
un lendemain de fête. Il faudra deux ans pour que Dylan fasse le deuil de cette
période magnifique, deux années de silence totale.

![[WebZine] ROCK In Progress](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNfpw0colnya1V0gJHAHt54gIhxELM8MqVV2_bYRj2_EfsfEpmYRQyio_VCWLAWBu6dj0MRUXnPMB76pFAhNmWfXvzx6m_kBEZa7DIhfsHYbDBjWy18iZ5nIEAzYcfDC3k3-pcRfth3F0/s1000/banni-RIP01%252Bfiltres.jpg)