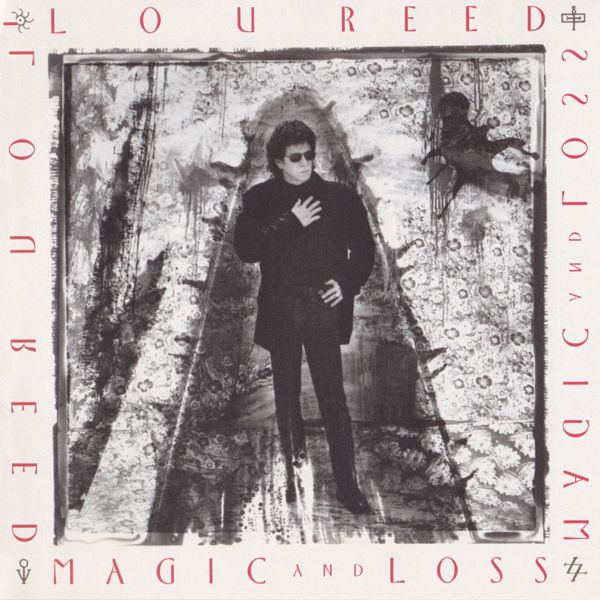David Bowie
Brian Eno
Adrian Belew
Carlos Alomar
Tony Visconti
Dennis Davis
George Murray
Sorti
en 1979, et toujours produit par Tony Visconti,« Lodger » marque la fin de la trilogie dite
berlinoise.
Mais « Lodger » apparaît toutefois plus comme un album de transition avant « Scary monsters » (dont il est finalement assez proche) car il est assez différent de Low et Heroes (en plus il n'a pas été enregistré à Berlin mais en Suisse).
Globalement bien sur c'est moins expérimental et avant gardiste que ses deux prédécesseurs» (il n'y pas de plages instrumentales), moins créatif, plus « classique » et accessible mais à mon avis injustement légèrement sous côté dans la discographie de Bowie.
Dans l'ensemble il est largement intéressant et réussi ; et on y trouve quelques petites perles pas forcément les plus connus dans la discographie du Thin White Duke.
Mais « Lodger » apparaît toutefois plus comme un album de transition avant « Scary monsters » (dont il est finalement assez proche) car il est assez différent de Low et Heroes (en plus il n'a pas été enregistré à Berlin mais en Suisse).
Globalement bien sur c'est moins expérimental et avant gardiste que ses deux prédécesseurs» (il n'y pas de plages instrumentales), moins créatif, plus « classique » et accessible mais à mon avis injustement légèrement sous côté dans la discographie de Bowie.
Dans l'ensemble il est largement intéressant et réussi ; et on y trouve quelques petites perles pas forcément les plus connus dans la discographie du Thin White Duke.
David
Bowie revient aux fondamentaux pop/rock (même si des éléments plus
new-wave sont présentes) avec notamment des titres au format plus
court.
L'album débute avec « Fantastic voyage », presque planant puis « African night flight » et là c'est marrant ce morceau me rappelle certaines ambiances de « Remain in light » des Talking heads...qui ne sortira qu'un an plus tard, le fil rouge entre les deux disques étant bien sur le génial Brian Eno (Bowie a toujours su remarquablement s'entourer au fil de sa carrière et Alomar et Belew aux guitares en sont encore la preuve).
Les titres, comme souvent chez David Bowie, sont d'une grande variété, diversifiés et c'est le cas sur Lodger : des tubes « Boys keep swinmming», « Look back in anger » (un grand morceau celui-là même si cela reste très classique), quelques expérimentations : le très oriental « Yassassin » (influences qu'on retrouvera aussi sur « Repetition ») et l'excellent « African night flight » » au rythme endiablé, des morceaux de bonne facture qui accrochent : « DJ », « Fantastic voyage » qui rappelle le Bowie du début des années 70's et qui par son ambiance aurait pu figurer sur Ziggy Stardust ou Hunky Dory et « Red Sails » sorte de chevauchée bien entraînante, presque épique.
Seuls les deux derniers titres s'essoufflent un peu, de même que « Move on ».
L'album débute avec « Fantastic voyage », presque planant puis « African night flight » et là c'est marrant ce morceau me rappelle certaines ambiances de « Remain in light » des Talking heads...qui ne sortira qu'un an plus tard, le fil rouge entre les deux disques étant bien sur le génial Brian Eno (Bowie a toujours su remarquablement s'entourer au fil de sa carrière et Alomar et Belew aux guitares en sont encore la preuve).
Les titres, comme souvent chez David Bowie, sont d'une grande variété, diversifiés et c'est le cas sur Lodger : des tubes « Boys keep swinmming», « Look back in anger » (un grand morceau celui-là même si cela reste très classique), quelques expérimentations : le très oriental « Yassassin » (influences qu'on retrouvera aussi sur « Repetition ») et l'excellent « African night flight » » au rythme endiablé, des morceaux de bonne facture qui accrochent : « DJ », « Fantastic voyage » qui rappelle le Bowie du début des années 70's et qui par son ambiance aurait pu figurer sur Ziggy Stardust ou Hunky Dory et « Red Sails » sorte de chevauchée bien entraînante, presque épique.
Seuls les deux derniers titres s'essoufflent un peu, de même que « Move on ».
Mais au delà des
compositions ce qui me subjugue toujours en premier chez Bowie c'est
la voix, toujours magique, album après album.
Depuis
le début des seventies et jusqu'à Scary Monsters Bowie s'est sans
cesse renouvelé quasiment album après album changeant de style (et de personnages),
devançant les modes. Là bien sur la créativité est moindre, encore qu'un titre comme « African Night Flight» explore un mélange d'influences assez inédits alors, mais
il n'empêche l'album tient la route et possède une fois de plus un
son qui sort de sentiers battus.
Peut-être un peu moins bon que « Heroes » et que « Scary monsters » (dans des genres différents) mais un album qu'on peut réécouter avec plaisir et qui reste pour moi dans la partie haute de la discographie de Bowie.
Celui-ci a certes fait mieux dans sa longue carrière mais cet album est vraiment chouette et attachant. Pas un disque à réhabiliter non, mais à remettre tout simplement à la lumière et lui donner la visibilité qu'il mérite.
Peut-être un peu moins bon que « Heroes » et que « Scary monsters » (dans des genres différents) mais un album qu'on peut réécouter avec plaisir et qui reste pour moi dans la partie haute de la discographie de Bowie.
Celui-ci a certes fait mieux dans sa longue carrière mais cet album est vraiment chouette et attachant. Pas un disque à réhabiliter non, mais à remettre tout simplement à la lumière et lui donner la visibilité qu'il mérite.
![[WebZine] ROCK In Progress](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNfpw0colnya1V0gJHAHt54gIhxELM8MqVV2_bYRj2_EfsfEpmYRQyio_VCWLAWBu6dj0MRUXnPMB76pFAhNmWfXvzx6m_kBEZa7DIhfsHYbDBjWy18iZ5nIEAzYcfDC3k3-pcRfth3F0/s1000/banni-RIP01%252Bfiltres.jpg)