Dans une sombre salle new yorkaise, un craquement d’allumette
perce dans le silence , comme la lumière au milieu des ténèbres. Détendu comme
jamais, plus prétentieux que dans ses heures les plus glorieuses , Lou Reed
sait qu’il a atteint le sommet de sa carrière. Ce soir-là , le public lui est
acquis d’avance, et les rares personnes conscientes qu’il représente désormais
le rock n roll sont réunies, comme si New York attendait le héros qui l’a si
bien dépeinte.
« Excusez-nous du retard nous étions en train de
nous accorder ».
Dès cette phrase, le public lui répond par une ovation chaleureuse,
un spectateur lui lançant cette ordre féroce « Take no prisonner Lou Reed ».
Et il commence par lancer une pique à Patti Smith, dont
le dernier album vient de sortir « It’s not radio Ethiopia , it’s radio
brooklin ! », avant de partir sur un sweet jane de plus de six
minutes , prétexte à quelques digressions pleines d’auto dérision.
I wanna be black part ensuite dans un free jazz fascinant
rappelant ce que Lou Reed déclarait à l’époque : « si tu ne sais
jouer ni le rock , ni le jazz, alors mélange les deux ! ». Malgré
cette touche d’humour ce passage est impressionnant de virtuosité, une fête
spectaculaire réinventant la notion d’orchestre rock. L’orchestre de Lou Reed
est plus rock que celui de Zappa, moins théâtral que celui de Springsteen, c’est
la chaleur du jazz copulant avec la puissance du pure rock n roll.
Derrière lui, le groupe chauffe comme l’autel d’une
célébration païenne, et donne la plus puissante version de satellite of love
jamais enregistrée. Portée par des chœurs fervents, et des cuivres chaleureux,
cette version transcende la beauté glam de l’original et , quand la guitare
succède à l’orchestre le temps d’un solo déchirant, on assiste véritablement à
l’assassinat de la suffisance glam. Présent dans le public, Springsteen a du apprécier cette version grandiloquente, qui n’est pas sans rappeler le charme théâtral de ses shows.
Chef d’œuvre du Velvet , « pale blue eyes » n’égale
pas la force de la version contenue dans live 1969, mais les chœurs font encore
des merveilles, sur ce qui restera un des meilleurs titres écrit par le poète
de New York.
Si vous voulez un chef d’œuvre, jetez-vous sur cette
version extraordinaire de Berlin. Ce qui, sur disque, était une introduction au
disque le plus magnifiquement déprimant que le rock ait porté, devient ici un
véritable requiem rock, une symphonie sombre débouchant sur une série de points d’orgues lumineux.
Après s’être laissé aller à la sensibilité sur les trois précédents
titres, Lou durcit de nouveau le ton, transformant « waiting for the man »
en blues incroyablement tendu. Comme au début du concert, Lou joue avec le public,
crachant sur les idoles de cette nouvelle génération (Patti en a pris pour son
grade en début de concert) , et improvisant des discours farfelus au milieu d’impros
qui étirent ses rythmes, comme Sergio Leone étire ses scènes.
Et puis, enfin, le break rythmique de waiting for my man
laisse place à une guitare suivant les cuivres dans un blues urbain et
menaçant, entrant ainsi dans un « temporary thing » qui porte
merveilleusement son nom. Boogie en deux accords, monument de feeling à une
époque où le rock semble le renier, ce titre est un magnifique pied de nez aux
surexcités à crête qui prétendent perpétuer le message de Lou.
Contrairement à ce qu’annonce sa pochette, ce disque n’est
pas punk, Lou est bien trop fin pour balancer les mêmes braillements niais. D’ailleurs,
la seconde partie du live creuse un sillon classieux bien éloigné des glaviots
de la bande à Rotten.
Et le voilà reparti dans ses sensibleries , partant dans
une version de cosney island babie capable d’hérisser le poil du skinhead le
plus endurci. Ce qui était une ballade introspective et philosophique devient une
catharsis fiévreuse, un crescendo vibrant porté par la chaleur des cuivres, et la
puissance de ses chœurs gospels.
Après le poète , l’animal rock n roll ne tarde pas à
refaire surface , introduisant « street hassle » par un solo plein de larsen, avant de lancer ironiquement « c’est comme ça que metal machine
music est né ». Lou Reed tient là le meilleur groupe de sa vie, le seul
capable de balancer un titre comme street hassle en live, avec autant de
justesse et de puissance.
La valse se fait encore plus solennelle, plantant cette
histoire glauque dans un décor solennel et fascinant. Avec Reed, la beauté et
la violence s’enchaînent, comme les scènes d’un film qui ne peut que mal finir,
et la guitare perce la mélodie comme le prêche annonçant la catastrophe. C’est
que la figure de Reed a toujours eu quelque chose de christique, et l’humour
contenu dans certains de ses monologues a surtout pour effet d’accentuer des
envolées, qui réussissent toujours à prendre l’auditeur par surprise.
On regrettera juste que Bruce ne soit pas monté sur scène
pour lancer sa déclamation , mais le riff final achève cette fresque de
manière grandiose. La longue jam de « walk on the wild side » lui
donne ensuite l’occasion de régler ses compte avec son passé , d’exprimer son
regret d’avoir mis fin au Velvet , tout en interdisant à son groupe de mettre
la moindre émotion dans son plus grand classique.
Ce satelite of love, il le veut froid, distant, comme
pour mettre fin à une époque où il n’était pas réellement lui-même. Est-ce parce
qu’il sait qu’un tel succès peut le tuer ? Est-ce pour affirmer une
liberté à laquelle il tient plus que tout ? Où faut-il y voir un autre
rejet de la production que Bowie lui a réservé ?
Ce qui est un des plus grands classiques du rock, il le
dépeint comme un bon morceau issu « d’un bouquin stupide sur des
infirmes », avant d’envoyer cette délicate attention à ceux qui lui ont
donné l’inspiration « Allez-vous pendre les mecs ». On l’a déjà dit,
avec Reed la violence et l’agressivité ne sont jamais loin, mais il est le seul
à lancer son fiel avec autant de classe.
La violence de Reed est fascinante comme pouvait l’être
celle de Lenny Bruce, c’est le cri de révolte du poète au milieu d’un monde de
fous. Et, si le public prend ses insultes avec reconnaissance , c’est parce
qu’il a conscience , comme le disait Dustin Hoffman dans le biopic consacré à
Lenny Bruce , « d’avoir besoin de ce genre de fous ».
Comédie subversive, concerto rock, poésie décadente, « take
no prisonner » est tout cela est bien plus encore. C’est le plus grand
live de celui qui voulait être « le Dostoïevski du rock ». Et quand « leave
me alone » clôt la céremonie sur une fureur proto metal asphyxiante, elle
laisse l’auditeur assommé par une œuvre unique , une réinvention vibrante de ce que
doit être un live rock.
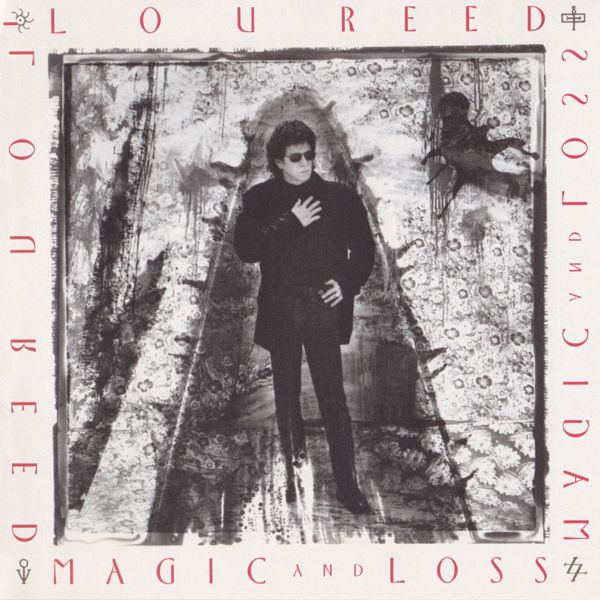
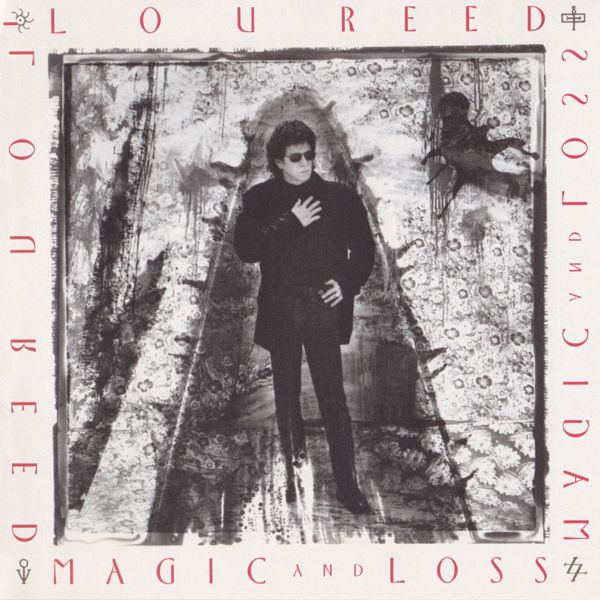
![[WebZine] ROCK In Progress](http://3.bp.blogspot.com/-eShAvmI56Sg/XCZThlRwdDI/AAAAAAAAAos/19T4foqHca46LjcWYH5V5ZbMmPx6o8UkACK4BGAYYCw/s1000/banni-RIP01%252Bfiltres.jpg)





:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-4896252-1407636896-8356.jpeg.jpg)