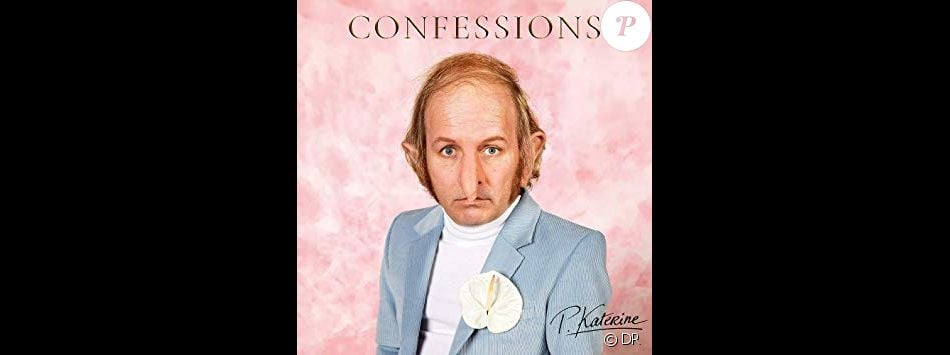:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-3488924-1407312259-7639.jpeg.jpg)
Le power trio est la base du rock , la formule qui lui permet d’atteindre la quintessence de son art . Si ses plus grands représentants, cream et l’experience de Hendrix, pouvaient se permettre de partir dans des expérimentations planantes ou jazzy, c’est parce que cette formule préservait cette force primaire qui fait le vrai rock n roll.
En 1999, gov’t mule est encore loin du raffinement élitiste qui fera le charme de sa seconde partie de carrière. Sorti quelques mois auparavant, son premiers album est un manifeste foudroyant , un pavé entrant dans la longue tradition du rock graisseux. Au centre de ce disque, leur reprise de « Mr Big » était leur « hey joe », une façon de saluer ses influences musicales, avant de tracer son propre sillon. Comme Lynyrd , gov’t mule est une réunion d’américains mordus de Free et autres fulgurances anglaises.
L’énergie qu’il développe sur son premier album a d’ailleurs autant de point commun avec ceux qui inventèrent un hard blues anglais , qu’avec le groove des rejetons des frères Allman. On pourrait même voir dans ce brûlot terreux l’aboutissement de ce que la bande à Van Zandt avait si bien représenté , avant de s’écraser dans un accident d’avion qui fût, pour les amateurs de boogie blues, ce que le service militaire d’Elvis fut pour les plus puristes. C’est-à-dire un traumatisme.
Mais ce serait faire l’impasse sur son petit frère « dose », où le groupe approfondit le sillon sulfureux qu’il a découvert. Ayant porté la jam au rang de source divine, le groupe de Warren Hayne continue d’y puiser la matière d’un groove secouant les racines de la musique du sud avec une certaine classe virile. L’esprit aventureux du Jazz dirige ainsi un vaisseau fou, lancé à cent à l’heure , sur une route parcourant les berges du missisipi . Le bolide est ici nourri par l’énergie issue du black country , terre natale de black sabbath, et théâtre des premiers exploits du duo Plant/ Bonham.
Ces improvisations sont autant de chemins tortueux, où le groupe forge son œuvre jusqu’à lui donner une force viscérale. Ils sont une bande de sculpteurs musicaux, recherchant à s’approprier l’art de leurs pygmalions. Ces instrumentaux sont leurs coups de burins passionnés, une matière faite de boucles hypnotiques, où le jazz devient l’opium du blues, la force électrique transformant le tout en lance transperçant les frontières qui séparent les sauvages à boucles blondes, les pionniers du blues spirituel, et les rednecks célestes.
Et ne venez pas me trouver là-dedans une énième répétition de ce que les frères allmans firent si bien quand skydog(Duane) les dirigeait de son doigté unique. Les allman n’auraient jamais lancé de tels assauts dignes de coups de canons sur les murs d’Alamo, leur purisme n’y aurait pas survécu.
Ecoutez « game face » , et sa batterie martelant avec une violence convoquant le fantôme de John Bonham, force qui oblige la guitare à rugir, pour imposer ses solos gras et lumineux. Ce titre est la représentation la plus pure de cette lourdeur délicieusement groovy , qui fait de cette musique un édredon sauvage, dans lequel peuvent se lover les amateurs d’une certaine classe burnée.
Sur les ballades comme raven black night , cette force entretient une pression fascinante. La centrale surchauffe et les explosions soniques sont grandioses. Hayne part d’ailleurs dans un solo s’apparentant à un lointain écho de ce que Gilmour développa lors de ses décollages cosmiques, sur un towerin fool en forme de blues céleste.
Puis tout le monde revient sur terre, et quitte à saluer ses racines autant brasser large. « John the revelator » est une danse voodoo que n’aurait pas reniée Dr John , un boogie poussièreux dans lequel les rythmes cajins saluent les esprits des natives americans, pendant que le spleen dansant vient rappeler ce vieil objet de fascination qu’est la musique afro américaine.
Des stones aux white stripes , les groupes les plus salués ne sont réellement devenus cultes que quand ils transcendèrent leurs influences. On reconnait un arbre à la solidité de ses racines, et à ce jeu-là , dose est peut être un des plus beaux fruits de l’arbre rock.
![[WebZine] ROCK In Progress](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNfpw0colnya1V0gJHAHt54gIhxELM8MqVV2_bYRj2_EfsfEpmYRQyio_VCWLAWBu6dj0MRUXnPMB76pFAhNmWfXvzx6m_kBEZa7DIhfsHYbDBjWy18iZ5nIEAzYcfDC3k3-pcRfth3F0/s1000/banni-RIP01%252Bfiltres.jpg)