
Le lendemain , Clint suit la route indiquée , le décor étant si proche de celui de « 3h 10 pour Yuma » , qu’il s’attend presque à être descendu par une canaille planquée sur un toit. Construite comme à l’époque des pionniers, les maisons rustiques ont juste abandonné leurs abreuvoirs à chevaux, devenus inutiles à l’âge de l’automobile.
Devant le studio , il aperçoit le groupe de dos , figé
dans une posture hostile, face à une bande d’hommes à la mine renfrognée. Van
Zandt se met à hurler comme pour mobiliser ses troupes.
« On va se les faire ces connards ! Je ne
changerais pas une note à des titres qu’on répète depuis des mois en concert ! »
Et là , Clint comprend que c’est ainsi que se déroulent
les relations musiciens/producteurs à Jacksonville. La tension est digne du
duel final du film « le bon la brute et le truand », quand le temps
semble se figer en attendant qu’Eastwood appui sur la détente. La bataille,
elle, fut moins cinématographique. Cette mêlée virile prenait d’ailleurs des
airs burlesques lorsque tous tentèrent d’éviter le gourou de l’ours Van Zandt.
Ajoutez à cela un chapelet d’injures des plus pittoresques,
et vous obtenez une scène surréaliste qui
aurait pu finir dans un film des Monty Pythons. Tout l’enregistrement fut à l’image
de cet épisode , un combat entre des ingés sons chargés de donner un vernis pop
à ce rock bourru , et des musiciens défendant leur intégrité artistique avec
obstination.
Si les combats ponctuant les sessions se déroulaient le
plus souvent en dehors des studios, il n’était pas rare de voir une bouteille
de jack atterrir sur la figure d’un pauvre producteur. A la fin des
enregistrements, Rickey résume le credo du groupe devant un verre de Jack :
« Tu vois gamin, le blues c’est une histoire de transmission.
Johnny Winter , Paul Butterfield , Mike Bloomfield , ils ont tous fait leurs
classes auprès de leurs grands frères américains. »
Il prend un gorgé, et continue sur le ton d’un conteur
tricotant des récits à la gloire des grands bluesmen.
« Jewtown , voilà la ville qui les attira tous , un
ghetto afro américain, où ils courraient jouer avec ceux qui les bercèrent. Le
rock a commencé à tuer l’apartheid là-bas, dans ce quartier ou les blancs
venaient en toute humilité, pour apprendre la culture noire qu’ils écoutaient en
cachette. »
Une certaine nostalgie finit par traverser ce visage, on
sent la gravité de la mission qu’il se donne à travers son expression solennelle.
« Aujourd’hui, le vinyle a remplacé la scène , les
gamins écoutent leurs galettes religieusement, pour y trouver leurs voies. Au
point que certains bricolent plus qu’ils ne jouent. »
Sentant la référence venir, Clint lance d’une voie
malicieuse : « Comme le dead ? »
« Non, même si ils ont inventé autre chose, Jerry
Garcia et sa bande de freaks étaient de vrais musiciens. »
D’un seul coup, ses traits se tendent , annonçant la
charge verbale qui va suivre.
« Mais regarde où en sont arrivés ses snobs anglais ! »
Il ponctue son exclamation d’un coup rageur, qui semble
faire sursauter les verres posés sur le comptoir.
« Ils citent le Jazz , la musique classique , le
tout noyé dans cette saloperie de sirop symphonique. Ils pensent que les références
masquent le vide de leur musique, mais ce n’est qu’une mode qui finira par s’éteindre. »
« Notre disque bottera le cul de Robert Fripp et
ses congénères pédants, la jeunesse va redécouvrir le rock. »
Le premier disque de Lynyrd sort quelques jours plus tard,
en cette belle année 71. Le
groupe est alors convoqué en première partie des stones, « le seul groupe
de rock anglais respectable » selon les sudistes.
Impressionnant de maitrise, ce qui ne devait être qu’un faire-valoir
devient une des attractions de la tournée américaines des stones, qui doivent
sortir le grand jeu pour éviter de se faire voler la vedette. En coulisse,
avant que leurs chemins ne se séparent définitivement, Keith apprend l’open
tunning à des Lynyrd médusés.
Les musiciens savouraient leur chance, et écoutaient
religieusement le riff master. Let it bleed , beggar banquets, sticky finger
formaient un trio sacré , une série de disques pop trempés dans la musique
fabuleuse des pionniers.
Keith est l’âme des stones, qui n’ont jamais été aussi
bon que depuis qu’il a renoué avec ses racines. Des racines étroitement liées à
cet open running, qu’il apprit auprès des bluesmens. Lynyrd ne s’en servira
jamais pour lui, mais ce soir-là il eut l’impression de découvrir un secret
historique.
Leurs albums se succèdent, le second représentant la face
plus « américaine » de Lynyrd. « Sweet home alabama »
succédait ainsi à free bird sur les radios américaines, même si le premier
reste plus populaire que son successeur.
Dans le bus qui emmène les musiciens en tournée, Clint
écoute les deux premiers disques en boucle depuis leur sortie. Ces deux
disques sont la quintessence du retour à la terre initiée par Dylan sur John
Whesley Hardin. Si pronounced lynyrd skynyrd, et sa beauté mélodique,
représentait la face « avant gardiste » du groupe , second helping
semble vouloir rassurer les fans de purisme poussiéreux.
D’ailleurs, son point d’orgue n’était même pas « sweet
home alabama », simple pique électrique dirigée contre le snobisme de « Mister
Neil Young », mais la « ballade of Curtis Law ». Avec ce titre, le groupe atteignait une grâce
digne de Johnny Cash, l’homme qui prouva mieux que tout autre la proximité
entre blues et country/folk.
La suite de la discographie des sudistes, si elle
contient encore quelques morceaux de bravoure, n’était plus aussi intense. Il
restait bien « one more from the road », live qui déchut les who de
leur titre de roi du hard blues, mais pourquoi Clint s’extasierait il devant
un enregistrement qu’il vit en direct chaque soir.
Nous voilà déjà arrivé au début de l’année 1977, cela
fait plus de cinq ans que Clint suit l’histoire du nouveau plus grand groupe du
monde, et Ronnie Van Zandt lui demande de le rejoindre au bar avec une solennité
qui ne lui est pas coutumière.
Penché sur son verre de Jack, le chanteur a un charisme
rustique , une carrure de Bud Spencer allié à la posture menaçante d’un Clint
Eastwood.
« Tu te rappelles ce que tu as dit lors de notre
première rencontre ? »
« Que ton groupe représentait le futur du rock
, et je veux écrire son histoire. »
« Ouaip ! Et bien il est temps que tu élargisses le cadre de ton récit. »
Ne sachant pas comment interpréter cette sentence, Clint
s’envoie une gorgée de whisky avec l’air attentif de celui qui s’apprête à
découvrir la conclusion d’un grand raisonnement.
« J’ai présenté une bande de petits gars à nos producteurs,
et ils pourraient bien mener la déferlante que j’ai annoncé avec Lynyrd. »
« Blackfoot va enfin sortir son premier disque ? »
« Non , Blackfoot deviendra un grand groupe , le
plus grand même. Mais notre musique ne peut attendre qu’il atteigne son zénith. »
Le chanteur marque une pause, s’irrigue la glotte, et son
teint prend les couleurs chaudes de celui qui ne compte pas ses verres.
« Les mecs s’appellent Molly Hatchet , et c’est bien
leur seul défaut… J’ai jamais compris pourquoi ils avaient choisi le nom de
cette vieille prostituée, qui réduisait ses clients en corned beef. Eux pensent
que ça sonne bien. »
« Il faudrait qu’ils soient sacrément bons pour me
donner envie de vous quitter ! »
« Ils le sont, et notre musique ne doit pas être l’affaire
d’une seule formation. Nous sommes comme Dylan au Gaslight , on vit pour
diffuser notre musique. Et puis ces mecs jouent le boogie comme des dieux, ils
marqueront l’histoire. »
Clint allait lancer une dernière contestation , mais
Ronnie le stoppa d’une poignée de mains virile.
« Je les ai prévenu, si tu doutes encore d’eux
écoute ça, ce sont les premiers titres de leur premier disque. »
Il lui donne la cassette, et se fige ensuite sur le pas
de la porte, dans une posture digne de John Wayne sur le point de partir
rétablir l’ordre dans les rues de Rio Bravo.
« T’as intérêt à être parti avec eux demain, sinon
je t’y envoie à coup de tiag dans le cul ».
« Une proposition pareille ne se refuse pas !
Bonne route Ronnie. »
« A la prochaine gamin ».
Clint a passé une bonne partie de la nuit à écouter la
cassette offerte par Ronnie, sidéré par ce groove familier. Ronnie avait
raison, un son du sud est né et il devait raconter son histoire.
Les sessions d’enregistrement du premier album de Molly furent
plus calmes, les producteurs savaient qu’ils tenaient désormais un bon filon, il
suffisait de le laisser s’épanouir.
Lançant ses discours abrutissants, un vieux poste de télé
hurle une phrase qui semble figer le temps.
« L’avion du groupe Lynyrd Skynyrd s’est écrasé,
entraînant notamment la mort de leur charismatique chanteur. »
Clint n’avait jamais vu ces solides gaillards aussi secoués,
figés comme si ils avaient entendu l’annonce de leur propre mort. Non, l’image
n’est pas trop forte, certains symboles ont des allures de blessures mortelles.
Ce n’est pas seulement quelques hommes qui ont disparu dans des circonstances effroyables, c’est l’âge d’or d’une jeunesse sudiste
devenue le centre du monde. Ce matin-là , Clint sait que l’âge bénie de ce rock
sudiste est déjà terminé, il ne se collera plus à ces groupes plus de quelques
jours.
Le genre était entré dans sa période « mature »,
et on lui colla une poignée d’historiens bourrés de références, il était temps qu’il
prenne part à ce grand inventaire.
![[WebZine] ROCK In Progress](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNfpw0colnya1V0gJHAHt54gIhxELM8MqVV2_bYRj2_EfsfEpmYRQyio_VCWLAWBu6dj0MRUXnPMB76pFAhNmWfXvzx6m_kBEZa7DIhfsHYbDBjWy18iZ5nIEAzYcfDC3k3-pcRfth3F0/s1000/banni-RIP01%252Bfiltres.jpg)

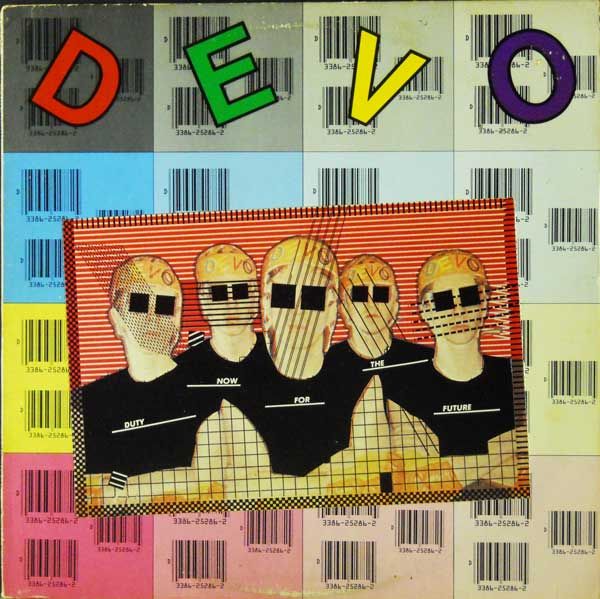


:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-3488924-1407312259-7639.jpeg.jpg)
