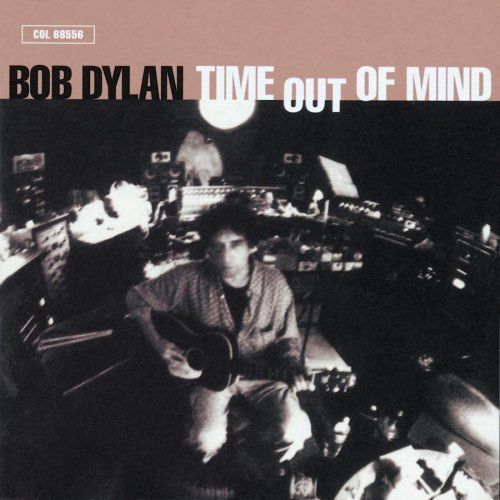« Iggy est quelqu’un de très cultivé , mais quand il
commence à sortir sa bite ça devient ennuyeux ». Voilà comment Bowie
parlait de son ami de Detroit , soulignant ainsi une facette que l’iguane
venait juste de dévoiler sur « the idiot » et « lust for life ».
Le titre du premier était un clin d’œil à Dostoievski , tandis que la musique
transformait le guerrier punk en crooner raffiné. C’est néanmoins l’énergie
punk du personnage, transpirant encore dans le riff de « lust for life »,
qui le rendit célèbre en rythmant les déboires d’Ewan Mcgregor dans « trainspotting ».
Après cela, le héros sorti de la dèche réclamait son dû,
aguichant le grand public avec la production clinquante de bla bla bla. Le
plan n’a pas marché plus que ça et, conscient que sa musique n’atteindrait plus
le sommet des hit-parades, il la vendit à l’annonceur le plus offrant. C’est
ainsi qu’est né le nouvel Iggy , homme sandwich entretenant son image et ses
créations en se vendant au plus offrant.
Toute tentative de s’éloigner de sa fureur stoogienne
était désormais vouée à l’échec , comme ce préliminaire, aux accents
expérimentaux pas si honteux que ce qu’on a pu en dire. Même lors du retour des
stooges , on lui reprochait une voix trop soignée , et des mélodies plus
évidentes qu’à la grande époque.
Pourtant , cette voix , semblant venir d’un vieux
guerrier ayant tout connu , est aussi fascinante que celle de son héros Jim
Morrison. Même post pop depression , annoncé comme un simple retour au rock
froid des années passées avec Bowie , prenait des allures lumineuses grâce à
cette voix chaleureuse. Iggy était désormais plus à chercher dans le manifeste
grave d’american vahalla , que dans les saillies de vultures . Tout l’album
était d’ailleurs doté de ce feeling de vieux baroudeur, quelque part entre
Sinatra et Morrison.
Voilà pourquoi ce disque, dans son concept comme dans sa
musique est le véritable aboutissement d’une carrière solo extrêmement riche. L’idée
donnant naissance à free a germé après que l’Iguane ait animé sa propre
émission de radio à la BBC. Là promu au rang de DJ , l’homme redécouvre le
goût du partage de sons peu diffusés , la soif de nouvelles découvertes , bref
tout ce qui définissait un DJ avant l’avènement de rayeurs de vinyles
décérébrés.
Forcément, ses sons ont nourri son imaginaire, pénétrant
dans son esprit pour y planter quelques graines fascinantes. On imagine, à l’écoute
de ce disque, que le Pop diffusait pas mal de jazz, tant free est marqué par
une douceur réconfortante que n’aurait pas renié Miles Davis.
Free ne ressemble à rien de ce qu’a produit Iggy , ce n’est
ni une giffle braillarde revigorante , ni un hommage foireux à quelques grandes
figures du passé. Ce n’est pas non plus un rock de crooner. C’est un disque
dans lequel il faut s’immerger, pour mieux en ressentir toute la beauté
poétique.
Oui , vous avez bien lu , le dernier album de l’iguane
est poétique . Une sensibilité se cachait sous ses airs de brute , tel un
personnage de Guy Des Cars *. Quand l’homme
chante « I want to be Free » , sur une musique atmosphérique , il
parle de ce sentiment qu’il a poursuivi toute sa vie, cette ivresse de celui
qui n’a ni attache , ni responsabilité.
C’est aussi ce sentiment qui l’a amené à courir après le succès,
torturé par cette confrontation entre les exigences du show business et ses
envies artistiques. A travers cette musique, sombre tout en restant lumineuse,
sobre tout en restant chaleureuse, il ne fait que montrer qu’il est venu à bout
de cette contradiction.
C’est là que l’homme se dévoile vraiment, citant Lou Reed
dans un décor musical introspectif et intimiste. Sans entrer dans le détail de
propos qui pourraient paraitre éminemment politique, on peut souligner qu’il s’agit
de la plus lumineuse poésie musicale depuis « the end », la poésie de
Lou Reed n’ayant jamais trouvé une voix aussi habitée.
James bond est plus rock avec sa rythmique irrésistible,
et toujours la voix du crooner pop lancée sur un bebop sautillant. On en regretterait
presque qu’il reprenne son rôle de chevalier punk, crachant sur la société de
consommation dans un langage fleuri que n’aurait pas renier Johnny Rotten sur
Dirty Sanchez.
C’est que , en effet , Iggy est tellement plus intéressant
quand il prend le temps de tisser ses ambiances méditatives , quand la musique expérimentale
emporte l’auditeur dans des paysages que l’on croyait réservés au jazz
expérimental.
Les musiciens sont grandioses, se contentant d’habiller
cette voix qui deviendrait presque une œuvre à elle seule. Ici elle porte l’étendard
d’un manifeste exprimant la victoire d’un homme sur son sentiment d’insécurité,
le vieux guerrier a trouvé son graal et l’expose à nos oreilles émerveillées.
*Guy Des Cars : La brute
![[WebZine] ROCK In Progress](http://3.bp.blogspot.com/-eShAvmI56Sg/XCZThlRwdDI/AAAAAAAAAos/19T4foqHca46LjcWYH5V5ZbMmPx6o8UkACK4BGAYYCw/s1000/banni-RIP01%252Bfiltres.jpg)