
Depuis 1977 , le rock est
victime d’une farce qui a trop durée . Toute cette bouillie inécoutable, lancée par un Joey Ramone au teint cadavérique, finira bien par tout détruire. Comment
une bande de cinglés en t shirt mickey , et incapable d’enchainer trois notes
correctement , peuvent ils lancer un mouvement qui infecte à ce point le rock.
Ces mecs ont juste volé une guitare à la boutique du coin , et se mettent à la
torturer avec une joie sadique qui rend Keith fou.
Le virus a fini par
atteindre l’Angleterre, qui n’a fait que le radicaliser. Johnny Rotten fait
passer ses appels à la révolte avant sa musique , qui de toute façon se résume à
un glaviot putride envoyé à la face du vrai rock. Nevermind the bollock était
une blague, ses auteurs semblaient d’ailleurs assez cynique pour en être
conscient, mais la blague a fait des disciples.
Seuls les clash paraissent
bon, mais le jugement de Keith est sans doute influencé par le fait qu’ils
aient ajouté du reggae dans leurs brûlots gauchistes. Et dire que les stones
sont passés à deux doigts de botter le cul de cette vermine à épingle à
nourrice.
Issu du groupe de Jeff Beck,
Ron Wood accélère le swing stonien , et son jeu rythmique ressuscite la
technique de la double guitare. Les stones la maitrisaient déjà avant que Brian
Jones ne commence à déconner, mais Mick Taylor avait enterré ce son. Quand
deux guitares jouent les même notes, on obtient le feeling ultime, et ce
feeling est la base des stones.
Bref, les stones ont
retrouvé un son plus tranchant, une poignée de compositions électriques donnait
le ton d’un « some girls » résolument rock. Et puis Mick a tout foutu en l’air. On s’est donc retrouvé avec, plantés au milieu de ce swing d’élite,
les guimauves pop « beast of burden » , « far away eyes », et le coup de grâce disco qu’est « miss you ».
Keith est interrompu dans
ses réflexions par un roadie , qui lui annonce qu’il est temps d’entrer en
scène. Ce que les stones ont raté sur disque, il compte bien le réaliser ce
soir. Ils ont donc choisi le sud-américain, berceau du rock n roll, pour
enregistrer un nouveau live.
Comme le montrait déjà
« some girls », la symbiose entre Ron Wood et Keith Richard est
parfaite. Son jeu plus agressif et rythmique met fin à la période blues entamé
sur Beggard Banquet, et marque ici le sommet la période rock des stones. Le
groupe de Keith Richard, autrefois célébré comme la réunion des plus grands
bluesmen de son époque, devient le sauveur du swing.
Les stones aiguisent le
riff de « all down the line », accélère le feeling boogie de star
star et when the ship come down, avant de défier Chuck Berry sur let it rock. On
regrette d’ailleurs, comme sur le disque précédent, que le groupe ne soit pas
allé au bout de sa radicalité rock.
Bien sûr, ils s’en sortent
magnifiquement sur les passages plus apaisés, mais Ron montre ses limites. « honky
tonk women » , « love in vain » , ou « brown sugar »
perdent donc un peu de leurs grooves bluesy , pour ne pas faire retomber la
pression d’une performance impressionnante d’efficacité.
Malgré ce petit bémol, et
les égarements mielleux que sont « miss you » , « beast of
burden » , et « far away eyes » , ce disque renvoie tous les
gamins à crêtes au berceau. Quand les stones font résonner les dernière notes
de « jumping jack flash » , qui clôturent ce « some girls live »
, ils sont redevenus le plus grand groupe de rock du monde.
![[WebZine] ROCK In Progress](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNfpw0colnya1V0gJHAHt54gIhxELM8MqVV2_bYRj2_EfsfEpmYRQyio_VCWLAWBu6dj0MRUXnPMB76pFAhNmWfXvzx6m_kBEZa7DIhfsHYbDBjWy18iZ5nIEAzYcfDC3k3-pcRfth3F0/s1000/banni-RIP01%252Bfiltres.jpg)



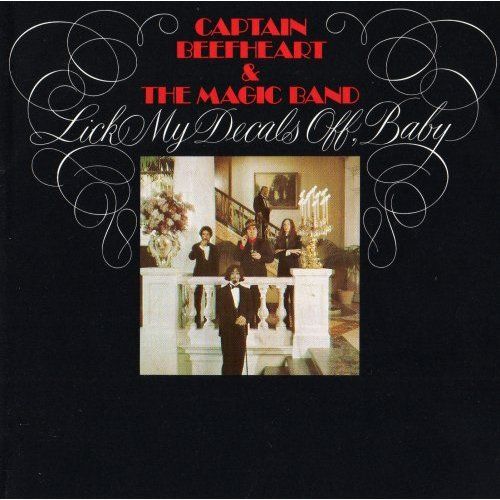

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-1139784-1390250862-4975.jpeg.jpg)